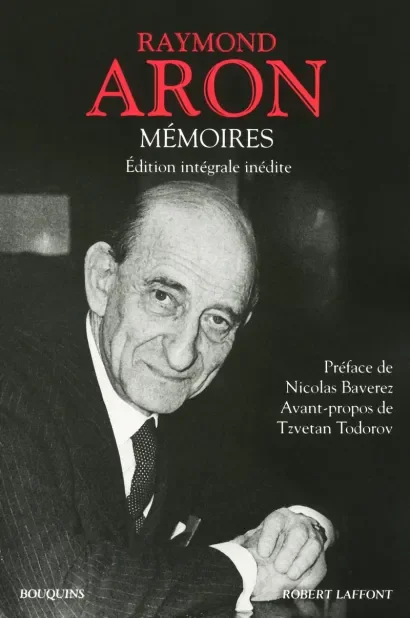1. Les années de formation
1905 → DÉBUT DES ANNÉES 30
École normale supérieure, section Lettres, promotion 1924. Assis de droite à gauche, Raymond Aron, Jean-Paul Sartre, Louis Herland, Paul Nizan ; debout, au premier rang, Georges Canguilhem, au deuxième rang, à droite, Daniel Lagache.
En 1924, Raymond Aron entre à l’Ecole Normale Supérieure où il entame des études de philosophie, la même année que Sartre et Nizan mais aussi Emmanuel Mounier et Daniel Lagache. Il soutient un diplôme d’études supérieures sur L’intemporel dans la philosophie de Kant et est reçu 1er à l’agrégation en 1928.
Chez un philosophe les années de formation jouent souvent un rôle décisif.
Chez Aron, elles sont à la fois marquées par l’accomplissement du rêve intellectuel familial et la précocité avec lequel le jeune philosophe va se frayer une voie singulière dans la philosophie de l’histoire au contact des événements historiques.
Le goût d’Aron pour la philosophie ne se démentira pas et la philosophie demeurera toute sa vie l’axe de sa réflexion. Quant aux amitiés intellectuelles qu’il noue à l’époque, elles ne résisteront pas à l’attrait pour le communisme auquel succomberont après-guerre de nombreux intellectuels de cette génération, à commencer par Sartre.
Extrait des Mémoires, Paris, Julliard, 1983, p. 21-22.
Raymond Aron - L’homme en question (1977)
de 1’04 à 2’55
Extrait des mots d’adieu de Georges Canguilhem lors des obsèques de R. Aron , le 20 octobre 1983.
« Cher Raymond Aron, Il y aura, l’an prochain, soixante ans que nous nous sommes rencontrés sur un chemin où tu t’étais engagé avec plus de préméditation que moi-même. Je sais maintenant, par tes Mémoires, ce que ta vocation devait à tes origines, à ta famille. Mais, dans notre jeunesse, nous nous intéressions peu à l’ascendance de nos amis. Tout nous semblait commencer avec nous-mêmes. Et, en 1924, la vie politique, en France, nous offrait une promesse de renaissance après les ruines de la Première Guerre mondiale. […] Tous ceux qui […] s’efforcent d’interpréter ce qu’ils nomment le scepticisme de Raymond Aron n’ont pas compris que l’absence de dogmatisme est chez toi l’effet d’une présence de la philosophie, assez éloignée de la philosophie universitaire française de nos années d’École normale, mais nullement improvisée. […] Les philosophes et sociologues allemands, Dilthey, Rickert, Max Weber, que tu étudiais dès 1932, t’ont inspiré une conception libérale de la philosophie de l’histoire, toute différente de celle qu’à la même époque les leçons de Kojève sur la philosophie de Hegel allaient inspirer à d’autres. »
1.1 – Famille
Raymond Aron naît, dernier d’une fratrie de trois garçons, le 14 mars 1905 à Paris dans une famille de la bourgeoisie juive d’Alsace-Lorraine où l’on ne transigeait ni sur le patriotisme, ni sur la culture. Son père, Gustave, se destine à une carrière de professeur de droit. Arrivé second au concours de l’agrégation, il mènera une carrière en demi-teinte que vient encore assombrir la crise de 1929 qui ruine la famille. De sa mère Suzanne, en retrait comme les femmes à l’époque, il signale seulement qu’elle goûtait les joies familiales. La réussite de son fils au concours de l’Ecole Normale Supérieure sera ressentie comme une revanche au moins sur le plan intellectuel. Comme toutes les familles du judaïsme français, l’Affaire Dreyfus puis la Première Guerre mondiale marqueront profondément le futur philosophe.
Maison de Versailles
(collection familiale)
“Les trois petits marrons”
(collection familiale)
Gustave et Suzanne Aron, parents de R. Aron
(collection familiale)
Avec les amis du Paribas Athletic Club, années 1930. Raymond Aron est le 2e en partant de la droite.
(collection familiale)
Radioscopie 1969 : la passion du tennis
de 7’45 à 8’15
« Aujourd’hui, regardant en arrière, je me juge sans indulgence ; le tennis occupa trop de place dans mon existence. Au lieu de profiter des vacances pour découvrir la France et l’étranger, je venais sur les plages de Normandie, pour prendre part aux tournois de l’été. Georges Glasser, polytechnicien, ex-p.-d.g d’Alsthom, fit équipe quelques années avec moi – ce qui témoigne de son bon caractère puisque mon service et ma volée étaient mes points faibles et me disqualifiaient pour le double. Mais ces regrets ne signifient rien. Je pris au tennis un plaisir extrême et le classement ne me laissait pas indifférent. »
1.2 – Rue d’Ulm
L’Ecole Normale Supérieure, qu’Aron intègre en 1924, est alors à la fois l’école de la République et le lieu où se forment les esprits les plus brillants. Les normaliens jouissent alors d’une grande liberté dans le choix de leurs études. Le directeur de l’époque Célestin Bouglé, durkheimien de la seconde génération, y fonde un lieu original, le Centre de Documentation sociale, dont Aron sera un temps secrétaire. C’est lui qui l’enverra pour des séjours d’études à deux reprises en Allemagne en 1930 et 1932. Dans La Guerre a eu lieu, M. Merleau-Ponty décrit pourtant un lieu hors du temps où les élèves vivent dans l’abstraction du monde des idées.
Jean-Paul Sartre (1905-1980)
Paul Nizan (1905-1940)
« Sartre est philosophe, mais la philosophie lui est un instrument littéraire. Aron n’est pas un philosophe “pur”, mais la philosophie est constamment à la source et à l’horizon de sa pensée. Pour l’un comme pour l’autre, cette “discipline”, ou plutôt cette attitude de l’esprit, est absolument fondamentale, mais elle ne définit entièrement ni l’un ni l’autre. Sartre en est plus éloigné qu’on ne l’a souvent cru, Aron plus proche qu’il ne le dit. L’un et l’autre, en tout cas, sont en quête de pensées qui leur permettent d’affronter le concret (les objets du quotidien comme la vie de l’homme dans la cité). Toujours l’engagement, toujours la réflexion transitive. »
Capsule audio : lecture d’un extrait lu des Mémoires, Paris, Julliard, 1983, p. 31-32
« Ma première impression, rue d’Ulm, je l’avoue au risque du ridicule, ce fut l’émerveillement. Aujourd’hui encore, si l’on me posait la question : pourquoi ? je répondrais en toute sincérité et naïveté : Je n’ai jamais rencontré autant d’hommes intelligents réunis en aussi peu de mètres carrés. Soit ! Ces bons élèves, ces prix d’excellence ne me semblaient pas tous voués aux exploits de la pensée. […] Venons aux deux normaliens de la promotion dont nous attendions beaucoup, qui n’ont pas déçu leurs admirateurs, dont l’un n’a pas eu le temps d’achever son œuvre et dont l’autre poursuivait, plongé dans la nuit, son itinéraire, plus moral que politique, quand j’écrivis ces lignes. […] Sartre et Nizan venaient tous deux d’Henri-IV, liés l’un à l’autre par une amitié rare même parmi les jeunes gens. Tous deux voués à la fois à la littérature et à la philosophie ; tous deux reconnus par leurs camarades comme hors du commun ; eux-mêmes conscients de leurs dons, déjà engagés sur leur route (Sartre échappait au doute, peut-être pas Nizan). Cela dit, ils participaient gaiement à la vie normalienne, sans le moins du monde se séparer des autres. […] Je garde le souvenir de ma satisfaction d’amour-propre quand j’appris par un tiers que les deux m’avaient placé du bon côté de la barricade, parmi ceux qu’ils ne rejetaient pas dans les ténèbres extérieures. »
1.3 – « Socialiste et pacifiste »
Au moment où Aron entre en philosophie, la discipline est dominée par la figure d’Alain (Emile Chartier) professeur dans la khâgne d’Henri IV. L’influence qu’exerce celui-ci ne s’arrête pas à la philosophie. Elle séduit la génération des jeunes philosophes par son engagement pacifiste, qu’Aron partagera jusqu’à la fin des années 1920 et son premier séjour en Allemagne. Le jeune Aron publiera ses premiers articles portant notamment sur la situation allemande et la montée du nazisme dans la revue d’Alain, les Libres propos. Quant à son engagement socialiste, s’il a rapidement cédé face aux réalités économiques, il s’est toujours manifesté chez Aron par des positions plus soucieuses des questions de justice économique et de mobilité sociale que celles de nombreux hommes de gauche.
Alain, Propos sur les pouvoirs, § 139.
Émile-Auguste Chartier, dit Alain (1868-1951)
« Penser, c’est dire non. Remarquez que le signe du oui est d’un homme qui s’endort ; au contraire le réveil secoue la tête et dit non. Non à quoi ? Au monde, au tyran, au prêcheur ? Ce n’est que l’apparence. En tous ces cas-là, c’est à elle-même que la pensée dit non. Elle rompt l’heureux acquiescement. Elle se sépare d’elle-même. Elle combat contre elle-même. Il n’y a pas au monde d’autre combat. Ce qui fait que le monde me trompe par ses perspectives, ses brouillards, ses chocs détournés, c’est que je consens, c’est que je ne cherche pas autre chose. Et ce qui fait que le tyran est maître de moi, c’est que je respecte au lieu d’examiner. Même une doctrine vraie, elle tombe au faux par cette somnolence. C’est par croire que les hommes sont esclaves. Réfléchir, c’est nier ce que l’on croit. Qui croit ne sait même plus ce qu’il croit. Qui se contente de sa pensée ne pense plus rien. »
Audio : lecture d’un extrait de R. Aron, « Remarques sur la pensée politique d’Alain », Revue de Métaphysique et de Morale, 57e Année, n° 2 (Avril-Juin 1952), p. 194.
« Qu’il s’agisse de la République radicale ou de la guerre, le centre de la pensée d’Alain est la distinction entre l’obéissance et la critique, en d’autres termes la distinction entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. En ce sens, il me paraît qu’Alain a touché l’essentiel. Autant que par ses institutions politiques ou économiques, une Cité est définie par la relation entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel, entre ceux qui ont la puissance de commander et ceux qui forment les esprits, entre les rois et les prêtres. On ne comprend rien à la crise des sociétés occidentales du XXe siècle si l’on n’aperçoit, en profondeur, la lutte entre les religions traditionnelles et les religions séculières, entre les prêtres et les intellectuels, entre les notables et les meneurs de masses. Alain n’a pas étudié la rivalité des deux pouvoirs en notre siècle, mais il a, dans le style de Bergson, dégagé ce qui lui a paru l’essence des deux pouvoirs. »
1.4 - Pontigny
Considéré comme l’un des esprits les plus prometteurs de sa génération, R. Aron est rapidement convié par leur fondateur Paul Desjardins aux Décades de Pontigny. Il y fera un exposé sur Proust dont la trace a malheureusement disparu. Il y fréquente les intellectuels du moment, y fait la connaissance d’André Malraux dont il deviendra proche et la rencontre de sa femme Suzanne Gauchon, amie proche de Simone Weil, que caractérisait sa finesse d’analyse et sa gentillesse et à laquelle il vouera l’amour de toute une vie. Trois filles naîtront de cette union, Dominique, Emmanuelle et Laurence.
Raymond Aron et sa femme, Suzanne à Pontigny
(collection familiale)
André Malraux (1901-1976) André Malraux en 1934
©Getty - Fred Stein Archive/Archive Photos
« Dois-je dire que la classe de philosophie me conduisit à l’Ecole Normale Supérieure et à l’agrégation parce que cette voie s’ouvrait d’elle-même ? Je me vouai à l’exercice intellectuel pour lequel j’étais le plus doué apparemment que pour les autres. Je crois cette sévérité excessive. La classe de philosophie m’avait enseigné que nous pouvons penser notre existence au lieu de la subir, l’enrichir par la réflexion, entretenir un commerce avec les grands esprits. Une année de familiarité avec l’œuvre de Kant me guérit, une fois pour toutes, de la vanité (au moins en profondeur). »
François Chaubet, Paul Desjardins et les Décades de Pontigny, Presses universitaires du Septentrion, 2000
« Ce fut en août 1910 que s’ouvrirent les premières Décades de Pontigny, dans le cadre d’une ancienne abbaye cistercienne rachetée en 1906 par un professeur de lettres parisien, Paul Desjardins ; closes en 1914, les Décades furent à nouveau organisées à partir de 1922, sans interruption jusqu’en août 1939. Chaque été, dans ce « village magique » (Vladimir Jankélévitch) de l’Yonne, se réunirent les élites intellectuelles de tous les pays afin de débattre sur des thèmes variés. Les sujets de discussion englobaient des questions politico-sociales, des questions philosophico-religieuses et enfin, des problèmes littéraires. Une durée de séjour de dix jours (décade) fut adoptée et chaque décade abritait en moyenne une vingtaine de personnes avant 1914, une cinquantaine après 1922. Vers 1924-1925, les Entretiens de Pontigny devinrent une étonnante réussite intellectuelle, voire mondaine ; le pèlerinage aoûtien vers l’abbaye amenait des hommes de lettres, des journalistes, de grands universitaires, des hommes politiques. Les décadistes signèrent le plus beau des livres d’or : de Gide à Valéry, de Malraux à Raymond Aron, de Charles du Bos à François Mauriac, de Léon Brunschvicg à Gaston Bachelard, d’Albert Thomas à Paul Langevin.»
Audio : lecture d’un extrait des Mémoires, Paris, Julliard, 1983, p. 77-78.
« C’est aux Décades de Pontigny […] que j’eus l’occasion de découvrir la haute intelligentsia de l’époque. Paul Desjardins m’avait invité à une décade en 1928, immédiatement après l’agrégation. J’y donnai une communication sur Proust qui eut l’heur de plaire à Anne Heurgon. J’aimai les décades ; les entretiens en eux-mêmes ne manquaient pas d’intérêt et, du reste, ils ne prenaient que quelques heures par jour. […] S’il n’y avait pas eu Pontigny, comment aurais-je pu passer dix jours avec André Malraux et nouer avec lui une longue et profonde amitié ? Roger Martin-du-Gard fréquentait fidèlement les décades sans jamais participer aux discussions […] En revanche, par sa générosité, sa simplicité, il gagnait également les sévriennes, plus tellement jeunes, et les jeunes agrégés, inquiets et ambitieux. […] C’est au cours d’une décade brillante de 1932 que je rencontrai Suzanne Gauchon qui devint la compagne de ma vie. Rien ne la destinait à fréquenter cette retraite d’intellectuels, en dehors de ses études au lycée Victor-Duruy. […] Suzanne, au lycée, eut pour camarades Christiane Martin-du-Gard, Edie Copeau qu’elle aimait tendrement et qui vit, religieuse, à Madagascar. Roger Martin-du-Gard témoignait à la camarade de sa fille une affection qui ne se démentit jamais. Il accepta d’être témoin à notre mariage en septembre 1933. »