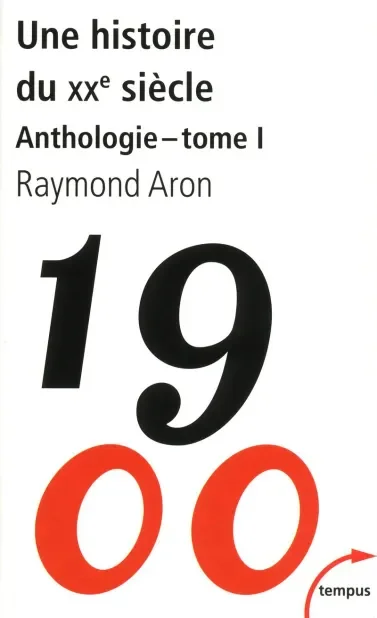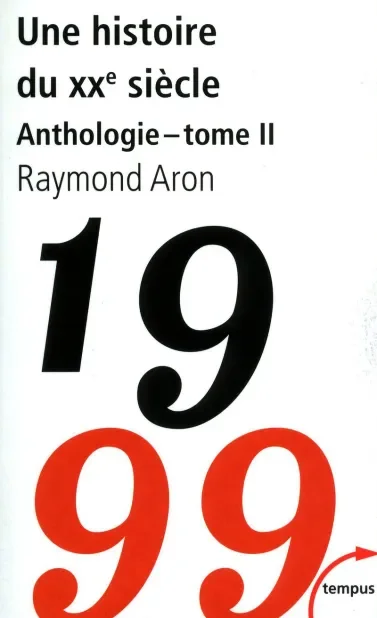6. Le gaullisme
1958 → 1969
Les relations complexes qu’Aron entretint avec le général de Gaulle, personnalité la plus citée dans les Mémoires, depuis l’époque de la Résistance jusqu’au départ du pouvoir de ce dernier, reflètent l’engagement et la distance qui furent le sien à l’égard de la chose politique et le regard critique qu’il garda sur ses acteurs. Aron fait la connaissance de de Gaulle au moment où il rejoint la Résistance à Londres en juin 1940. S’il admire le chef de la France Libre, il ne partageait pas sa conception de l’exercice du pouvoir, il critiqua le culte de la personnalité et la vision mythique de l’histoire comme en témoigne l’article d’août 1943 paru sous le litre « L’Ombre des Bonaparte ». Après un bref compagnonnage comme directeur de cabinet du ministre André Malraux en 1945, Aron ne cessa de prendre ses distances d’avec le gaullisme tout en rendant hommage au rôle historique du Général.
Extrait de : Raymond Aron, Mémoires, Julliard, 1983, chapitre 9, « Journaliste et militant », p. 239
« Je n’ai jamais été gaulliste à la manière de Malraux, attaché au Général par une sorte de lien féodal. Je ne l’ai pas été non plus à la manière de Maurice Schumann, bien qu’il n’ait pas suivi le Général pendant les années du RPF. Mes relations avec de Gaulle ont toujours été ambiguës, y compris pendant les années du RPF, pour des motifs à la fois obscurs et profonds. »
R. Aron sur Charles de Gaulle et son adhésion au RPF :
Apostrophes (extrait), 23/09/1983
Extrait de la préface de Jean-Claude Casanova au livre Aron et de Gaulle, Calmann-Lévy, 2022, p. 41-42
« Le plus simple que l’on puisse affirmer est que Raymond Aron a admiré de Gaulle sans toujours l’approuver. Il l’a approuvé dans ses choix décisifs : en 1940, à la création du RPF, pour la Constitution de 1958, pour la réforme économique et monétaire de 1958, pour l’application du traité de Rome, pour la politique nucléaire, pour l’indépendance de l’Algérie, pour le retour à l’ordre en 1968, pour son attitude pendant les crises de Berlin et de Cuba. Il a voté oui au référendum de 1958 en faveur du projet de Constitution. Au second tour de l’élection présidentielle de 1965, il a choisi de voter pour le général de Gaulle plutôt que pour François Mitterrand. Il l’a désapprouvé sur d’autres questions, que l’on considérera selon les analyses que chacun peut faire comme moins ou comme très importantes : les rapports avec les États-Unis au sein de l’organisation atlantique, les propos sur le peuple juif tenus lors de la conférence de presse de 1967, le discours de Phnom Penh, en 1966, si indifférent à l’emprise communiste s’étendant sur le Vietnam et si offensant pour le pays qui nous avait deux fois secourus militairement, en 1917 et en 1944, et continûment sur le plan financier depuis 1947. Le propre d’Aron, disait Bernard de Fallois, tient à ce qu’il déteste autant la malveillance que la complaisance. Je crois qu’il ne fut à l’égard de de Gaulle ni malveillant ni complaisant, mais équitable et le plus souvent approbateur. À chacun de dire si le de Gaulle réduit aux approbations d’Aron restitue le général dans toute sa grandeur historique ou au contraire le réduit, le redimensionne, comme disent les Italiens, et si c’est le cas, dans quelle mesure ? »
6.1 - L’Algérie
Aron fut l’un des premiers à affirmer dès avril 1956 la nécessité de l’indépendance de l’Algérie, inéluctable pour des raisons liées à l’évolution démographique et de la situation économique et politique du pays, mais aussi pour des raisons politiques. Il fut accusé de défaitisme et violemment pris à parti par les partis de droite et les partisans de l’Algérie française. La Tragédie algérienne dont The Economist salue à l’époque l’importance fut l’une des occasions de l’intervention directe de R. Aron dans le débat politique.
Extrait de R. Aron, La Tragédie algérienne, Plon, 1957. Repris in R. Aron, Une histoire du XXe siècle. Anthologie, Plon, 1996.
« Dire que l’Algérie n’est pas la France, reconnaître la personnalité politique algérienne, c’est, au fond, avouer qu’il y aura demain un État algérien. Et, s’il doit y avoir demain un État algérien, celui-ci, après-demain sinon demain, sera en théorie indépendant. La politique a sa logique, quoi qu’on en ait. [...] Au moment où la catastrophe est là, il est trop tard ou trop tôt pour faire le bilan et répartir les mérites et les torts. A cette raison élémentaire – un pays ne peut sans déshonneur abandonner un million des siens – les politiques peuvent joindre deux autres raisons. Il serait peu honorable de sacrifier les musulmans qui furent nos amis, de les abandonner à la fureur d’une minorité violente. Il serait peu raisonnable de méconnaître que la manière dont l’Algérie accédera à l’indépendance peut être de portée immense pour l’avenir aussi bien du pays lui-même que de l’Afrique du Nord et de l’Occident tout entier. » (p. 540-541)
Les 4 généraux rebelles (de g. à d., André Zeller, Edmond Jouhaud, Raoul Salan et Maurice Challe) à la fin de l'insurrection (Putsch d'Alger), 26 avril 1961. ©Getty - Keystone France
Extrait de Raymond Aron, « Après le coup d’Etat, avant la négociation », Preuves, n°124, juin 1961. Repris in in R. Aron, Une histoire du XXe siècle. Anthologie, Plon, 1996.
« Mai 1958, janvier 1960, avril 1961, les trois dates marquent, si l’on veut, trois étapes de la marche fatale de l’armée française vers le coup d’État de type sud-américain. Elles illustrent aussi les péripéties, plus cyniques qu’édifiantes, de la politique algérienne du Pouvoir. Les vainqueurs du 13 mai, quand l’autodétermination a été proclamée en janvier 1960, et en avril 1961 l’indépendance accordée, ont eu le sentiment d’avoir été joués. Ils ont été privés de la révolution que les gaullistes leur ont subtilisée. Si le droit à l’insurrection était sacré contre le parti de l’abandon de la IVe République, si, comme le disait jadis le Premier ministre, le devoir d’obéissance cesse du jour où un gouvernement envisage d’aliéner une partie du territoire national, pourquoi les quatre généraux seraient-ils des criminels et non des héros malheureux ? Personnellement, je ne doute pas qu’ils aient été criminels : l’exemple de l’Espagne nous prouve qu’il n’est pas de pire infortune pour une nation qu’une armée qui compense son abaissement au-dehors par des prétentions politiques à l’intérieur. »
Raymond Aron analyse le rôle joué par le Général de Gaulle au moment des événements en Algérie, d'une part par rapport à la IVe République, d'autre part par rapport à l'opinion française. Antenne 2, 18.10.1981
6.2. - Israël
Aron s’est souvent interrogé sur la manière dont il avait traversé l’événement que fut l’extermination des juifs. Sa judéité qu’il n’a jamais reniée s’exprima le plus clairement au moment de la guerre des Six-jours et de la conférence de presse du général de Gaulle. Il critiqua la politique de la France, mais surtout réagit avec passion à l’accusation lancée par le Général. De Gaulle, Israël et les juifs, (« peuple d’élite, sur de lui et dominateur ») où il rassemble ses réflexions, aborde en profondeur sa condition de juif et son lien à l’Etat d’Israël. Il y reviendra à plusieurs occasions par la suite.
Conférence de presse du Général de Gaulle, 27 novembre 1967, dans le contexte de la récente « guerre des Six Jours » :
« Certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est à dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent, une fois rassemblés dans le site de leur ancienne grandeur, à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles : l'an prochain à Jérusalem. »
Raymond Aron, De Gaulle, Israël et les Juifs, Plon, 1968.
« Définir un "peuple" par deux adjectifs : un homme d’État s’abaisse lui-même lorsqu’il recourt à un pareil procédé, celui des stéréotypes nationaux, des préjugés raciaux, celui dont les habitués du Café du Commerce ne se lassent pas et dont psychologues et psychiatres analysent infatigablement les mécanismes. Le général de Gaulle s’est abaissé parce qu’il voulait porter un coup bas : expliquer l’impérialisme israélien par la nature éternelle, l’instinct dominateur du peuple juif. Pourquoi ce coup bas ? Je ne sais. [...] La phrase relative au peuple juif "resté sûr de lui-même et dominateur", ne répondait nullement aux besoins de la démonstration. Que les Juifs constituent ou non un peuple, qu’ils soient ou non dominateurs, l’établissement d’un foyer juif en Palestine risquait, en effet, peut-être même devait-il inexorablement entraîner des conflits interminables. Et la dialectique de l’hostilité, à son tour, pouvait inciter les Israéliens à l’agressivité, sans pour autant que le peuple juif, par nature et à travers les siècles, soit et reste "sûr de lui-même et dominateur". » (p. 15)
6.3 - Mai 68
Mai 68 est apparu à Aron comme un vaste psychodrame, jugement que ne lui ont jamais pardonné l’ensemble des protagonistes. La distance avec laquelle il évoque, dans La Révolution introuvable, les événements de 68 tient à la fois à l’analyse qu’il donne du soulèvement étudiant et le faisceau de causes sociologiques et politiques auquel il renvoie, mais également à la séduction qu’exerce le thème révolution sur les intellectuels. Usage de la Raison contre fascination pour l’événement et sa violence. Ce diagnostic ne lui sera pas plus pardonné qu’en 1955 la dénonciation des « hommes de foi » dans l’Opium des Intellectuels. Sartre écrira en 1968 qu’Aron était « indigne d’être professeur ».
R. Aron, La révolution introuvable, Plon, 1968.
« Ce petit livre, entretiens dans la première partie, recueil d’articles publiés dans Le Figaro dans la seconde, appartient à la littérature de combat, comme La Tragédie algérienne. Livre d’humeur, il n’a pas la prétention de dire la vérité ou le sens de l’événement, il a pour objectif de le démystifier, de le désacraliser. » (p. 13)
« Les étudiants expriment-ils une protestation pour ainsi dire métaphysique contre une civilisation qui, faute de croyances transcendantes, semble emportée en une aventure folle vers plus de savoir et plus de pouvoir, sans fin dernière, sans discipline de sagesse ? Si les engins balistiques, les bombes thermonucléaires, la course à la Lune et la course aux armements symbolisent la phase actuelle de l’histoire, comment s’étonner qu’une partie de la jeunesse estudiantine hésite entre la négation hippie, l’aspiration à la violence salvatrice et la fuite vers une nouvelle utopie ? » (p. 18).
©AFP
Extrait de la préface de Philippe Raynaud à R. Aron, La Révolution introuvable, Calmann-Lévy, 2018, p. II et XI.
« Parmi tous les livres publiés dans le sillage des "événements" de Mai 68, La Révolution introuvable est sans doute le seul qui prend en compte tous les aspects de la crise. Aron voit dans la "révolution" de Mai un signe de la fragilité des sociétés industrielles, mais il n’ignore pas les aspects singuliers que prend cette crise dans une société française où l’égalitarisme de l’idéologie nationale va de pair avec la permanence d’un style très hiérarchique dans les rapports sociaux, et il donne aussi une analyse très fine de la crise politique que connut alors la Ve République. [...] Cette analyse proprement politique est aujourd’hui assez généralement oubliée, parce qu’on s’intéresse surtout aux effets sociaux ou "sociétaux" de Mai 68, mais elle constitue cependant un modèle de ce que savait faire la "science politique" classique, dont on oublie trop souvent qu’Aron a été l’un de ses bons représentants dans la France de l’après-guerre.»
Capsule audio : Radioscopie. Raymond Aron / Jacques Chancel – France Inter - 23 juin 1969. Sur Mai 68 (de 33’38 à 38’07)